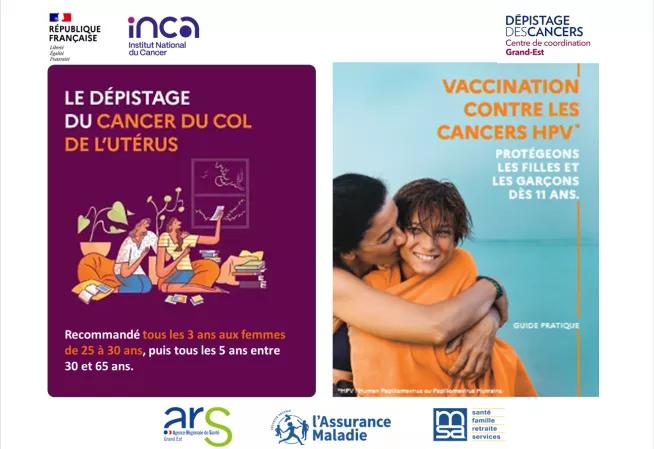Des échanges nourris sur le terrain
Professionnels de santé, institutions, associations, représentants d’usagers, entreprises et collectivités ont participé aux ateliers participatifs du matin, selon la méthode du world café : travail collaboratif. Objectif : identifier les besoins, les réponses possibles apportées par la télémédecine, les freins rencontrés et les leviers du développement des usages de la télémédecine à destination des publics vulnérables. La diversité des profils a permis une approche croisée, nourrie à la fois par des considérations médicales, sociales et techniques. Les discussions ont mis en avant des pratiques déjà éprouvées dans la région - comme les actes de téléexpertise, ou les sites de téléconsultation soutenus dans le cadre de la nouvelle feuille de route régionale de la télémédecine 2024-2026 co-portée par la Préfecture de région Grand Est, le Conseil régional Grand Est et l’Assurance maladie, tout en soulignant la nécessité de renforcer l’inclusion numérique et la formation des professionnels.
Une après-midi consacrée à l’éthique du numérique en santé

L’après-midi, ouverte à un public plus large, a abordé les enjeux éthiques du numérique en santé aux côtés notamment de l’Espace de Réflexion Éthique du Grand Est, de France Assos Santé Grand Est et de la cellule éthique de la Délégation du Numérique en Santé. Après avoir questionné la notion de vulnérabilités, deux tables rondes ont interrogé l’équité d’accès aux soins avec la téléconsultation et la qualité des pratiques à distance avec la télésurveillance médicale. Les retours d’expériences des acteurs en région, les témoignages des représentants des usagers, les présentations des productions de guides et la plateforme d’éthicovigilance nationale [1] ont permis d’illustrer les préoccupations de chacun, d’identifier les questionnements éthiques et de partager les vigilances dans le déploiement des usages de la télémédecine.
« La télémédecine n’est pas une fin en soi, mais un outil au service d’une santé accessible à tous, partout, et dans le respect de la dignité de chacun », a rappelé le Dr Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ARS Grand Est, dans son discours d’ouverture. Elle a également souligné que « la technologie, aussi performante soit-elle, doit servir l’humain », appelant à une télémédecine « inclusive, éthique et ancrée dans les réalités de nos territoires ».
Une contribution régionale à la feuille de route nationale
Les conclusions des travaux du Grand Est viendront alimenter la synthèse nationale des Assises, dont la restitution est prévue en janvier 2026. Elles nourriront également l’actualisation de la feuille de route régionale de la télémédecine 2024-2026, qui guide le déploiement d’outils numériques au service des parcours de santé.
Et demain ?
L’ARS Grand Est poursuit, avec ses partenaires, la dynamique engagée autour du numérique en santé : accompagnement des territoires pour soutenir le développement des usages de la télémédecine, et valorisation des pratiques éthiques. Ces perspectives s’inscrivent dans une ambition commune : faire de la télémédecine un levier durable d’équité et d’accès aux soins pour tous.
La télémédecine est une pratique médicale à distance. Elle implique au moins un professionnel de santé (médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste,…) et répond aux mêmes exigences que les soins en présentiel : déontologie, sécurité, confidentialité, traçabilité.
L’éthique du numérique en santé se définit tout d’abord par rapport aux quatre principes fondamentaux du serment d’Hippocrate auxquels a été ajouté un cinquième principe à propos de l’écoresponsabilité.
La Bienfaisance : Les outils numériques en santé répondent aux besoins des utilisateurs, leur procurent un bénéfice. Ils aident notamment les professionnels de santé à exercer leur pratique professionnelle. Ils permettent aux patients qui le souhaitent d’être pleinement acteurs de leur santé.
La Non-malfaisance : Les outils numériques en santé ne sont pas toxiques, ne génèrent ni stress ni colère des utilisateurs, ne leur causent aucun préjudice. Selon ce principe, les outils numériques et leurs usages doivent garantir la confidentialité des données de santé, protéger la sécurité des patients. Ils doivent également pouvoir être utilisés sans contrepartie malveillante.
L’Autonomie : Les utilisateurs des outils numériques (qu’ils soient patients ou professionnels de santé) doivent conserver leur autonomie de pensée, d’intention et d’action lorsqu’ils prennent des décisions. Les utilisateurs sont également capables d’adapter/paramétrer les outils et services numériques (sans forcément avoir recours à une prestation de l’éditeur) afin que ces outils numériques puissent leur rendre le service attendu.
La Justice & Équité : Les outils numériques permettent aux utilisateurs d’être justes en proposant une égalité de traitement des personnes. Les charges et les avantages des procédures de soins, en particulier les traitements, doivent être répartis équitablement, sans discrimination. Le stockage et l’usage des données doivent permettre la même prise en charge dans des situations similaires.
L’Écoresponsabilité : La responsabilité environnementale des outils numériques vise à limiter les impacts environnementaux et leurs conséquences néfastes sur la santé humaine. Elle relève de la non-malfaisance.