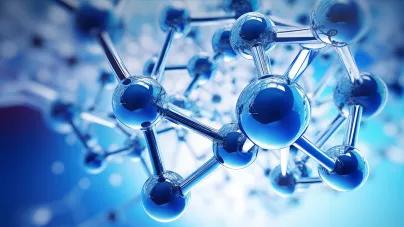Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS) représentent près de 4 000 composés chimiques synthétiques. Ils sont utilisés, depuis les années 1950, dans un grand nombre d’applications industrielles et dans des produits de consommation pour leurs propriétés antiadhésives, résistantes aux fortes chaleurs et imperméabilisantes :
- Composants pour emballages alimentaires en papier et en carton ;
- Mousse anti-incendie ;
- Produits utilisés pour la photographie, la lithographie ;
- Le fart utilisé sous les skis pour améliorer la glisse ;
- Isolant pour fils électriques, câbles électroniques ;
- Certains produits ménagers, agents ou imperméabilisants ou antitaches dans l’industrie du textile (vêtements de pluie, moquettes et tissus d’ameublement) ;
- Ustensiles de cuisine anti-adhésion, embouts buccaux de cigarette électronique, semelles de fers à repasser ;
- Lubrifiants et cires pour sols et voitures, dans la fabrication de cosmétiques ou encore agents antibuée, antistatiques ou réfléchissants pour vernis et peintures
- Traitements phytosanitaires.
La présence de PFAS dans l’environnement est uniquement liée à l’activité humaine.
Très persistants et résistants à la dégradation, il est possible d’en retrouver des traces dans l’environnement (eau, air, sol) et dans la chaîne alimentaire, y compris des molécules qui ont été interdites depuis plusieurs années (d’où l’appellation de « polluants éternels »).
Toute la population est exposée, à des niveaux variables. La principale source d’exposition est l’alimentation, en particulier :
- la consommation de produits de la mer, de viande, de fruits, d’œufs,
- dans certains cas, la consommation d’eau de boisson.
L’air intérieur et extérieur est aussi une voie d’exposition possible, ainsi que l’ingestion de poussières contaminées.
Les PFAS, tout comme d'autres substances chimiques, peuvent présenter des risques pour la santé, surtout lorsqu'on y est exposé de manière répétée et sur le long terme.
Les informations scientifiques les plus récentes, résumées dans le rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de juillet 2020, montrent qu'une exposition fréquente aux PFAS peut avoir des effets potentiels sur la santé tels que :
- la diminution de la réponse immunitaire à la vaccination chez les enfants ;
- la diminution du poids à la naissance ;
- des taux élevés de cholestérol ;
- une perturbation du fonctionnement du foie.
D’après l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), 4 PFAS doivent faire l’objet d’une attention particulière car ils contribuent le plus à l’exposition et au risque potentiel pour la santé : PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS.
En novembre 2023, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé le PFOA comme « cancérigène pour l’homme » (groupe 1) et le PFOS comme « peut-être cancérogène pour l’homme » (groupe 2B). La production de ces deux PFAS est interdite depuis plusieurs années.
D’autres effets sur la santé ont été mis en évidence par des études toxicologiques sur l’animal mais n’ont pas été prouvés chez l’homme, comme par exemple des perturbations de l’équilibre endocrinien (hypothyroïdie), des troubles de la reproduction, de la fertilité, une augmentation du risque de cancer (cancers du rein ou des testicules).
L’objectif de ces études est de produire des valeurs de référence d’exposition pour la population française.
Etude Esteban
Le niveau d’imprégnation de la population française a été mesuré par l’étude Esteban publiée en 2019 par Santé Publique France. Elle a été réalisée sur un échantillon de 744 adultes et 249 enfants durant deux ans (2014 à 2016). 17 PFAS étaient recherchés.
Les résultats ont montré que 7 étaient régulièrement quantifiés chez les adultes et 6 chez les enfants. Le PFOA et le PFOS (substances désormais interdites) ont été quantifiés à 100 % chez les enfants et les adultes. Des différences de niveaux d’imprégnation ont été observées selon le sexe, l’âge, l’indice de masse corporelle, la consommation de poissons et des produits de la mer, de légumes, l’autoconsommation d’œufs et de lait, l’utilisation des produits ou matériaux pendant les travaux de loisirs ou de bricolage.
Enquête Albane
L’enquête Albane, qui prend la suite d’Esteban, actualisera sur l’ensemble du territoire national ces valeurs de référence.Elle sera copilotée par Santé publique France et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). La phase pilote de cette étude nationale commencera en 2024 et le terrain du premier cycle de 2025 à 2026 pour des résultats à partir de 2028 sur le volet biosurveillance.
Concernant l’exposition des nourrissons, ils peuvent être exposés durant la grossesse et l’allaitement, le cas échéant lors de l’utilisation de l’eau pour la confection des biberons. A noter que le passage des PFAS dans le lait maternel est connu et documenté. Cependant, les taux d’imprégnation aux PFAS des nourrissons allaités au sein rejoignent, en grandissant, ceux des autres enfants et l’allaitement reste bénéfique (source : Institut fédéral allemand d’évaluation des risques).
L’organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que l’allaitement maternel est recommandé de façon exclusive jusqu’à 6 mois et au moins jusqu’à 4 mois pour un bénéfice santé. Même de plus courte durée, l’allaitement maternel reste toujours recommandé.
En janvier 2023, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires avait publié un premier plan ministériel sur les PFAS. Ce plan, piloté en région par la DREAL, visait à contrôler les industries émettrices ou utilisatrices de PFAS en vue d’en réduire les impacts sur l’environnement. 5000 sites industriels sont concernés en France, dont 525 environ en Grand Est.
En avril 2024, un Plan d’action ministériel sur les PFAS | Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (ecologie.gouv.fr) vient structurer les actions en réponse aux préoccupations grandissantes concernant les impacts des PFAS sur la santé humaine et la biodiversité. Le plan d’action interministériel sur les PFAS intègre et se substitue aux actions prévues dans le plan du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, publié en janvier 2023, sur ce même sujet. Le pilotage de la mise en œuvre de chacune des actions du plan d'action interministériel sur les PFAS est attribué à l’ensemble des ministères mobilisés (santé, écologie, industrie, consommation, recherche, agriculture, intérieur, armées, etc.), opérateurs (Ineris, BRGM, Ifremer etc.) et agences (Anses, Santé Publique France, Ademe, Agences de l'eau, etc.).
Ce plan s’organise autour de cinq axes :
- Développer des méthodes de mesure des émissions, des contaminations de l’environnement et de l’imprégnation des humains et des autres organismes vivants ;
- Disposer de scénarios robustes d’évaluation d’exposition des organismes (humains et autres organismes vivants) prenant en compte les multiples voies (ingestion, inhalation, contact cutané) et sources d’exposition aux polluants ubiquitaires que sont les PFAS ;
- Renforcer les dispositifs de surveillance des émissions ;
- Réduire les risques liés à l’exposition aux PFAS ; innover en associant les acteurs économiques et soutenir la recherche ;
- Améliorer l’information auprès de la population, pour mieux agir.
La coordination des actions et le suivi de la mise en œuvre du plan seront assurés par un comité de pilotage interministériel réunissant l’ensemble acteurs.
Loi PFAS
Le 27 février 2025, la loi PFAS a été promulguée et vise à protéger la population des risques liés aux substances PFAS. Il sera notamment interdit à compter du 1er janvier 2026 d’utiliser des PFAS dans les cosmétiques, les farts de ski, les vêtements. Cette loi demande également aux ARS de rendre publiques, notamment sous la forme d’un bilan annuel, les analyses PFAS des eaux destinées à la consommation humaine. Elle demande également de porter au contrôle sanitaire les 20 PFAS définis par la directive eau potable, en anticipation de la date de constat de conformité fixée au 12 janvier 2026 par la réglementation européenne.
Pour en savoir plus :
Le contrôle de l’eau de consommation est assuré par l’Agence Régionale de Santé Grand Est qui agit pour le compte des Préfets de département. Ce contrôle sanitaire de l’eau potable est réalisé par des laboratoires agréés.
La réglementation en matière de contrôle des PFAS dans l’eau potable a évolué suite à la publication de la directive européenne de 2020 sur l’eau potable : PFAS : surveillance dans l’eau potable | Agence régionale de santé Grand Est (sante.fr)