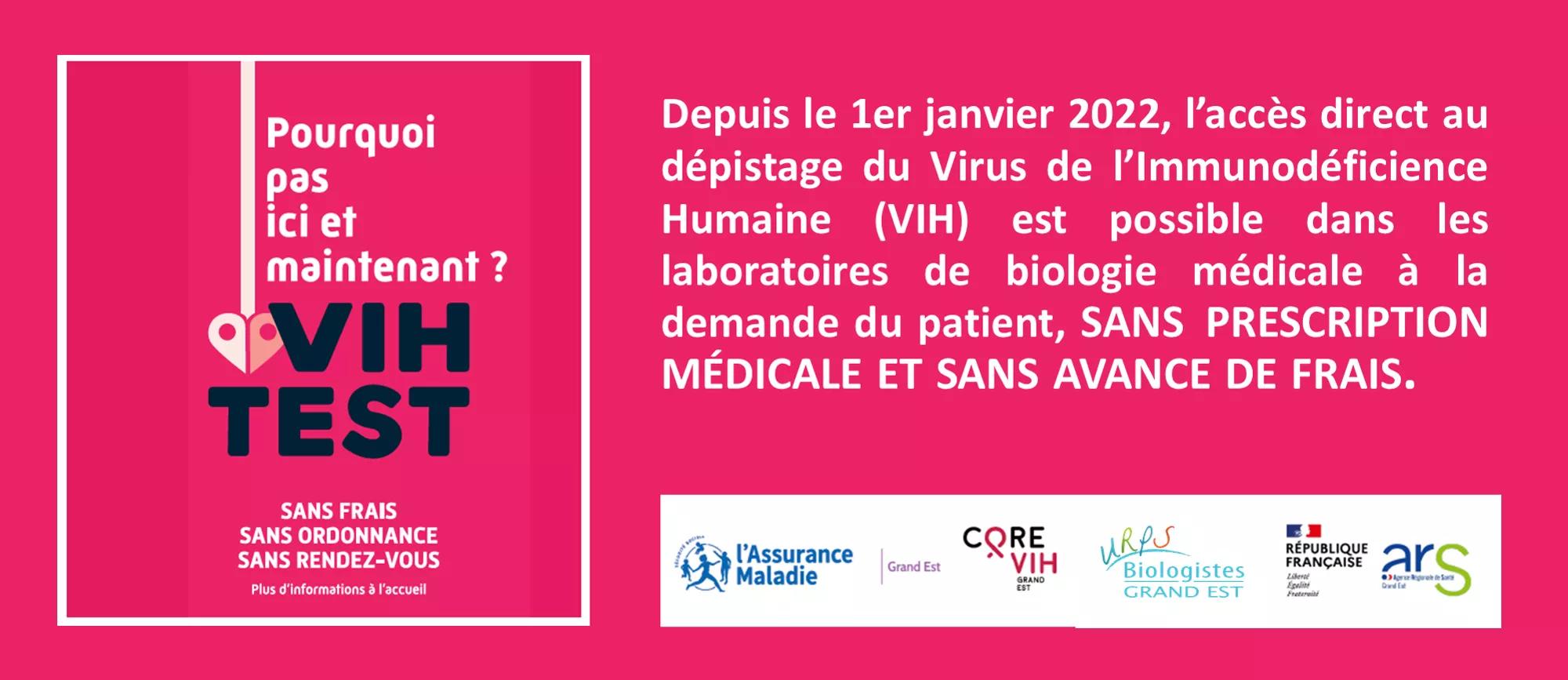
En France, les infections sexuellement transmissibles continuent de progresser et touchent particulièrement les 15-30 ans. Elles représentent un problème majeur de santé publique.
Les plus graves (VIH, VHB, VHC) peuvent entraîner des maladies chroniques et menacer la santé des personnes. Chaque année, près de 6 000 personnes découvrent leur séropositivité au VIH et environ 4000 nouvelles contaminations au virus de l’hépatite C sont enregistrées.
Les plus connues et souvent les plus bénignes (gonococcies, chlamydiae, syphilis, HPV), si elles ne sont pas dépistées et rapidement soignées, peuvent entraîner de sérieuses complications : cancers (papillomavirus), atteintes neurologiques irréversibles (syphilis), stérilité (chlamydiae et HPV), ou encore vulnérabilité accrue face aux VIH et aux virus responsables des hépatites (par altération des muqueuses et affaiblissement des défenses immunitaires).
Largement accessible, le préservatif est le moyen de prévention le plus répandu. Il reste la méthode de base pour se protéger et protéger les autres du VIH (virus de l'immunodéficience humaine) et des Infections sexuellement transmissibles (IST), et pour prévenir les grossesses non prévues.
Il en existe deux types de préservatif
- le préservatif externe, le plus accessible, à dérouler sur le pénis ou un sextoy ;
- le préservatif interne, moins répandu, à poser dans le vagin ou le rectum.
Pour une efficacité maximale, tout préservatif s’utilise avec un gel lubrifiant à base d’eau (le lubrifiant déjà présent sur le préservatif ne sert qu’à le dérouler aisément).
Un préservatif remboursé
Depuis le 10 décembre 2018, sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme, le préservatif peut faire l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie.
Cette prise en charge concerne aussi bien les femmes que les hommes et est proposée en pharmacie en différents formats (boites de 6, 12 ou 24 préservatifs).
C’est une nouvelle étape en faveur de la prévention.
Pour en savoir plus
Grâce aux avancées scientifiques, la lutte contre toutes les IST se décline aujourd’hui selon une palette d’outils appelée « prévention combinée » ou « prévention diversifiée ».
Outre l’outil de base que représente le préservatif, il existe :
Le dépistage régulier
Il est recommandé tous les 3 mois à toutes les personnes multipartenaires, sur les 3 sites de prélèvement (gorge, urètre, anus) et pour toutes les IST ; il est également vivement conseillé au moindre symptôme suspect dans la zone ano-génitale.
Le Treatment as Prevention (TasP)
A destination des personnes séropositives au VIH, ce traitement antirétroviral rend leur charge virale (quantité de virus dans le sang) indétectable.
Une personne séropositive et indétectable ne peut plus transmettre le VIH.
La prophylaxie préexposition (PrEP)
A destination des personnes séronégatives, ce traitement antirétroviral est pris avant une exposition au VIH et empêche le virus d’entrer dans l’organisme. Ce traitement peut être prescrit par tout médecin.
Pour plus d’infos : « Mon ticket PreP - Le DOC pour parler PreP avec ton DOC »
Le traitement post-exposition (TPE)
Après toute exposition accidentelle au VIH (rapport non protégé suite à une rupture de préservatif, agression sexuelle, ou encore accident d’exposition au sang), ce traitement antirétroviral (délivré dans les services d’urgences et les CeGIDD) est à prendre dans les toutes premières heures après l’exposition au VIH pour une efficacité optimale (au plus tard sous 24h).
La réduction des risques et des dommages (RDRD)
Chaque personne peut adopter une série de mesures régulières pour réduire les risques de transmission des IST : surveillance des symptômes suspects dans les zones intimes, surveillance des petites plaies sur les doigts ou dans la bouche qui favorisent les contaminations, communication transparente avec ses partenaires, usage d’autres outils de prévention (digues buccales, doigtiers, etc.).
Différentes personnes, différents besoins, différents modes de dépistage
Stress lié à l’attente des résultats, crainte d’être stigmatisé, difficulté à trouver du temps ou à obtenir un rendez-vous… Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire repousser le dépistage. Heureusement, il existe plusieurs modes de dépistage pour répondre à toutes les situations.

Ces dernières années, l’offre de dépistage s’est développée. Il existe ainsi cinq façons de faire un test de dépistage VIH et/ou infections sexuellement transmissibles (IST).
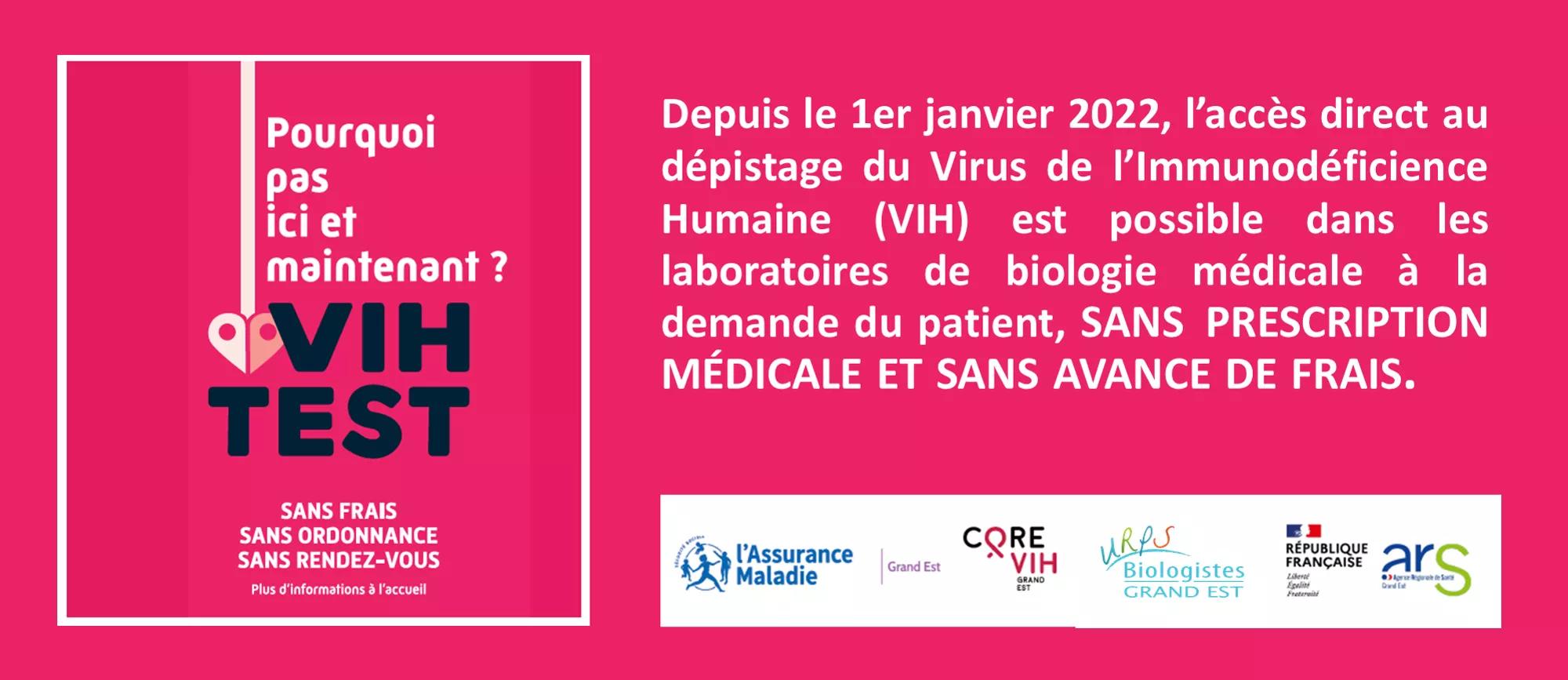
Déjà expérimenté dans plusieurs régions de France, il permet à toute personne qui le souhaite d’effectuer un test de dépistage, gratuitement et sans prescription médicale dans tout laboratoire d’analyses. Le dispositif est étendu à l’ensemble du territoire depuis le 1er janvier 2022.
Le dispositif donne au biologiste le statut de professionnel de santé de proximité pour l’entrée en parcours de soin, tout en lui offrant l’appui d’un opérateur régional en cas de besoin. En Grand Est, l’opérateur identifié est le Corevih.
Pour en savoir plus, téléchargez le flyer :
2. Le test dans un CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic du VIH, des hépatites et des IST).
Ce test est gratuit, anonyme, sans rendez-vous. Ces centres peuvent proposer le dépistage des autres IST.
Les CeGIDD en Grand Est :
- ou accédez à leur localisation géographique grâce au site du COREVIH Grand Est.
3. Le TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique)
Le TROD est proposé par les acteurs associatifs, ce test est gratuit, anonyme, permet d’avoir un résultat rapide et d’être accompagné par des chargés de prévention formés.
Vous trouverez ci-dessous les documents nécessaires pour effectuer une demande d’habilitation ou d’autorisation TROD VIH/VHC/VHB auprès de l’ARS Grand Est conformément à l’arrêté du 16 juin 2021
4. L’autotest
En vente dans les pharmacies, il permet de faire le test soi-même et d’obtenir un résultat rapide, quand on veut, où l’on veut.
En savoir plus : le site du COREVIH Grand Est
5. Mon Test IST
Depuis le 1er septembre 2024, il est possible de se faire dépister pour les 4 principales IST (gonococcie, syphilis, chlamydiae et hépatite B) en laboratoire et sans ordonnance, à l’image du dispositif VIH-Test en vigueur depuis 2022.
Ce dépistage est intégralement pris en charge par l’Assurance maladie pour les moins de 26 ans ; pour les plus de 26 ans, il est pris en charge à hauteur de 65% par l’Assurance maladie, le reste étant couvert par les mutuelles et complémentaires santé.
La combinaison de l’ensemble de ces outils de prévention a conduit l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à se fixer pour objectif le contrôle de l’épidémie à VIH.
Cet objectif est désormais atteignable si les trois critères suivants sont remplis :
- 95% des personnes séropositives connaissent leur statut : de nombreuses personnes vivent avec le VIH sans le savoir et le transmettent à leur insu, d’où l’importance du dépistage régulier ;
- 95% des personnes diagnostiquées séropositives bénéficient d’un traitement antirétroviral : l’espérance de vie en bonne santé d’une personne séropositive est désormais la même que pour une personne séronégative (elle n’atteint plus le stade sida, seuil ultime où le système immunitaire ne fonctionne plus), si elle est dépistée tôt ;
- 95% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable : elles ne peuvent plus transmettre le VIH.















